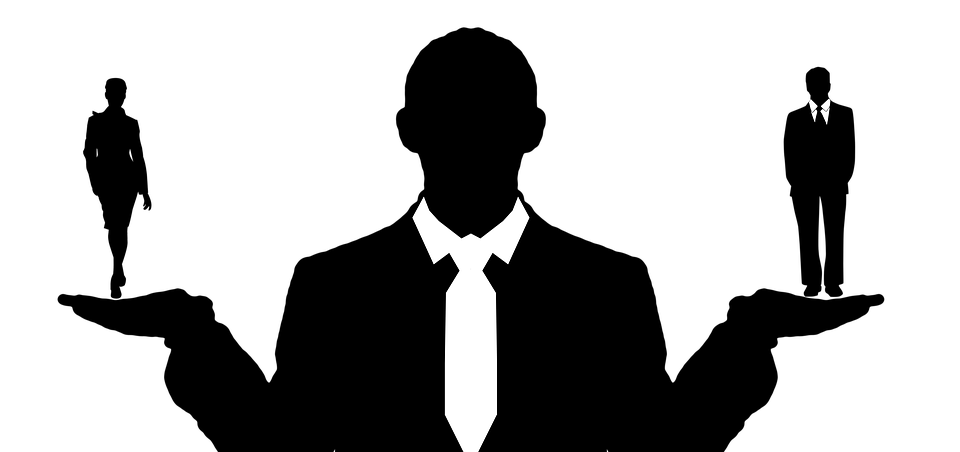Les médias, et particulièrement la télévision, nous inondent chaque jour de mauvaises nouvelles. Ils nous donnent à voir un monde anxiogène, empli de violences. Lassée de cette négativité, une partie du public et des journalistes se tourne peu à peu vers le journalisme constructif.
Titres chocs, images inquiétantes, musiques angoissantes, champ sémantique de la peur… Les chaînes d’information, tenues par des impératifs d’audience et de rentabilité, diffusent des images anxiogènes sur nos écrans de télévision, nous offrant une vision catastrophiste du monde. Un phénomène qui a été amplifié ces dernières années avec l’arrivée de nombreuses chaînes d’information en continu. À l’origine de ce catastrophisme généralisé, il y a la croyance, dont il est difficile de dire si elle est avérée, que les mauvaises nouvelles se vendent mieux que les bonnes.
Néanmoins, une chose est sûre : par ce tourbillon d’informations alarmantes, les médias activent tout au long de nos journées notre amygdale cérébrale, gestionnaire de nos émotions. Les trois émotions principalement stimulées sont la peur, la colère et la tristesse. Or, cette exacerbation émotionnelle produit des décharges d’adrénaline et de noradrénaline qui vont nous maintenir « scotchés » à l’info, nous captiver. De quoi peut-être expliquer en partie les records d’audience enregistrés par les chaînes de télévision lors des catastrophes, qu’elles soient naturelles ou provoquées ?
« Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez »
Selon Jacques Lecomte, expert de la psychologie positive, cette sur-médiatisation des nouvelles alarmantes finit par produire un décalage problématique entre le ressenti du public et la réalité du monde. Cela rejoint la théorie du syndrome du Grand méchant monde, une expression inventée par le chercheur américain George Gerbner pour décrire le phénomène observé lors de ses études, selon lequel les actes de violence rapportés dans les médias contribuent à créer chez le public l’image d’un monde plus dangereux qu’il ne l’est en réalité.
Une réalité que Jacques Lecomte s’attache à rétablir dans son livre Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez. Pour lui, le déclic a eu lieu en 2015, année de la vague d’attentats, lorsqu’il a découvert le bilan de l’ONU sur le Millénaire pour le développement, qui contenait 8 objectifs pour le développement dans le monde. « J’ai été frappé du décalage entre ce qu’ont raconté les médias, qui se sont surtout intéressés aux failles, et le document que j’avais lu », témoigne-t-il.
L’objectif du Millenaire était très ambitieux, certaines choses n’ont pas été faites. Mais les hauts responsables de l’ONU, les chefs d’Etat, et les petites mains des ONG se battent depuis 15 ans pour faire avancer au mieux les choses…ils y parviennent, mais on leur dit que ça ne va pas, car ils n’ont pas atteint les objectifs. C’est déprimant et injuste !
Dans son ouvrage, il met en lumière les réalités positives, sur lesquelles les médias font majoritairement l’impasse. Il démontre, chiffres à l’appui, que ces dernières années sur l’ensemble du globe, la pauvreté, l’analphabétisme, les maladies et la violence n’ont jamais tant reculé.

Les effets insidieux de l’alarmisme médiatique
A travers ce livre, Jacques Lecomte prône ce qu’il appelle l’opti-réalisme, « un double regard, à la fois positif et lucide. Dire que le monde va mieux que nous le pensons ne signifie pas que le monde va bien. Mais le réalisme, c’est aussi de mesurer le chemin déjà accompli. »
Car pour lui, la façon qu’ont les médias de dépeindre le monde peut s’avérer dangereuse. En induisant la peur, ils inciteraient à des mesures autoritaires. « La peur et les mauvaises nouvelles augmentent le sentiment de nationalisme et rend hostile envers les étrangers », croit le psychologue. Il estime également que cette méthode démobilise les citoyens : « L’excès d’informations sur les problèmes sans montrer les solutions peut avoir un effet contraire à celui prévu. Avec cette vision négative et catastrophiste que nous offrent les médias, moi citoyen lambda, je ne peux rien faire face à l’immensité de ces problèmes. ». Une opinion partagée par le sociologue Dominique Wolton, qui considère, dans le journal Le Temps, en 2016, qu’ « Écouter des mauvaises nouvelles à longueur de journée génère un sentiment d’impuissance voire de désespoir. ».
Une solution : le journalisme constructif
Deux possibilités s’offrent aux personnes qui ne supportent plus ce déferlement de mauvaises nouvelles. Certaines prennent la décision radicale de se déconnecter au maximum des médias. C’est le cas de Gaëlle, 50 ans : « Écouter les informations me met en état de stress. C’est lourd à porter. Nous avons déjà tous nos lots de problèmes dans la vie quotidienne, et les informations viennent ajouter de l’inquiétude, de l’angoisse à tout cela. Je me sens bien plus sereine quand je cesse de m’informer ».
Face à cette actualité tragique, d’autres, en revanche, partent à la chasse aux « bonnes nouvelles ». La sphère journalistique a vu émerger il y a quelques années une nouvelle façon de traiter l’actualité : le journalisme de solutions, aussi appelé journalisme constructif. Gilles Vanderpooten, directeur de l’association Reporters d’Espoir à l’origine du journalisme de solution en France, le définit comme : « Un journalisme qui non-seulement fait le travail conventionnel qui est d’aller dénoncer et analyser les dysfonctionnements du monde, mais qui va un peu plus loin en s’intéressant aux forces de construction, de résilience, aux réponses qui sont apportées par les individus, les collectifs, les structures ». Un journalisme de problèmes et de solutions, en somme. « Quelque part, c’est le journalisme tout court, puisqu’en théorie, un journaliste est là pour s’intéresser à toutes les dimensions d’une situation… » ajoute-t-il.
De plus en plus de médias adoptent, au moins partiellement, ce journalisme constructif. En France, Nice Matin en est le principal exemple. Après avoir frôlé la faillite en 2014, le journal a décidé d’innover en développant une offre numérique de journalisme de solutions. Aujourd’hui, plus de 6000 personnes sont abonnées, et les contenus sont très partagés. « Il y a une véritable attente de nos lecteurs pour ce type de contenu. On reçoit beaucoup de retours positifs », confiait Damien Allemand, responsable du service digital de Nice Matin, à InaGlobal en 2016. Plus largement, il y a des rubriques, des émissions nouvelles qui sont apparues, comme « Circuit Court » sur Europe 1, où sont interviewés des acteurs de changement, ou encore « On a la solution » sur France 3, tous les jours à 7h50.
Quand il n’est pas définitivement adopté par les médias, le journalisme constructif est intégré de façon ponctuelle. Chaque année, Libération et Ouest France proposent des numéros spéciaux consacrés aux solutions, vendus en plus grand nombre que les numéros traditionnels. Pendant la semaine de La France des solutions, organisée chaque année en octobre par Reporters d’Espoirs, une trentaine de médias proposent des sujets « constructifs » pendant une semaine.
A la Une de @libe ce week-end : Le réveillon du futur (Libé des solutions) https://t.co/UDXhlCqOYA pic.twitter.com/HBmrdmaHax
— Libération (@libe) 23 décembre 2016
En cinq ans à la tête de l’association Reporters d’Espoirs, Gilles Vanderpooten a constaté une réelle évolution. Il est confiant quant à l’avenir du journalisme constructif. « Il y a une dynamique qui n’existait pas avant. Des journalistes nous contactent spontanément, alors qu’avant c’est nous qui allions vers eux. Au Figaro, à l’AFP, au Monde, il y a des gens aujourd’hui qui nous rejoignent alors qu’il y a six ans c’était impensable. ». Selon lui, cela s’explique par le fait que « Le modèle axé sur le saignant et la catastrophe ne fonctionne plus autant qu’avant. Il y a des journalistes eux-même qui en ont assez, qui cèdent sous le poids de la négativité, qui ont envie d’autre chose ». Il voit cette transition comme une nécessité. « C’est une responsabilité du journaliste vis à vis de la société, de ne pas montrer que les raisons de désespérer, mais témoigner aussi que l’on peut reprendre le pouvoir sur les événements. Il y a souvent face à une catastrophe la possibilité d’entreprendre une action, individuelle ou collective…».